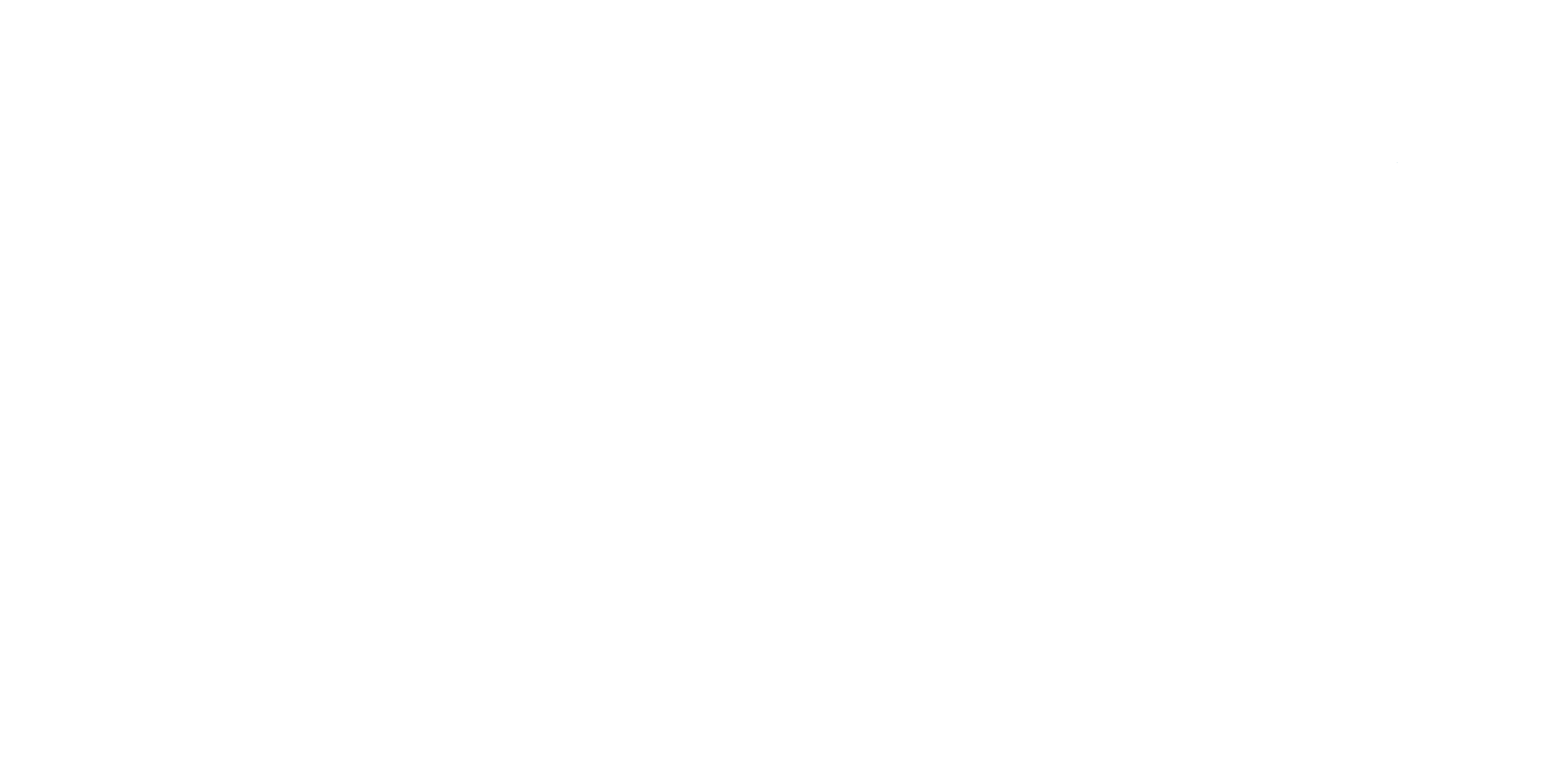- Accueil
- Le blog de l'ESDES
- Recherche
- La démission silencieuse (quiet quitting) : Un lapsus révélateur
Audric Mazzietti
5 min.
1 juin 2023
Par Audric Mazzietti, Laurent Vilaine (https://www.revuegestion.ca/la-demission-silencieuse-quiet-quitting-un-lapsus-revelateur)
La langue est un instrument de pouvoir, de sorte qu’un abus de langage peut parfois cacher un abus de pouvoir. C’est le cas de ce qu’on appelle en anglais le quiet quitting, qu’on peut traduire en français par « démission silencieuse ». Loin de rendre compte d’une réalité objective, ce concept dépeint une vision biaisée et asymétrique de la relation qui lie entreprises et travailleurs. Ainsi, la sémantique sert ici à affirmer une forme d’inégalité sociale entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent les tâches, lesquels font l’objet de soupçons permanents d’inadaptation et, donc, d’illégitimité. Décryptage.
La démission dite silencieuse fait référence à ces employés qui disent non aux tâches ne relevant pas de leurs fonctions et qui ne travaillent pas en dehors des horaires prévus par leur contrat ; autrement dit ni les soirs ni les week-ends. Or, considérer qu’un travailleur qui refuse de faire plus que le travail pour lequel il est payé est en situation de « démission » en dit long sur les enjeux de pouvoir liés au travail. Pareille notion sous-entend qu’exécuter le travail pour lequel on reçoit une rémunération n’est pas suffisant et qu’il faudrait donc en faire plus pour son entreprise. Une telle injonction pose d’emblée l’idée d’une relation asymétrique dans laquelle l’entreprise tient le rôle de bienfaitrice devant une main-d’œuvre qui devrait s’estimer heureuse et chanceuse de pouvoir travailler. Seulement, cette sémantique péjorative, voire dédaigneuse galvaude l’idée même de la relation de travail, qui, par essence, est une transaction, un échange de production contre rémunération.
L’employé montré du doigt
Ce sens corrompt aussi le cadre de réflexion dans lequel le travail est pensé, si bien que, plutôt que de remettre en question le travail comme tel, on s’interroge sur le travailleur, pour ne pas dire qu’on l’accuse. On met en doute sa perte de sens, son mal-être, sa charge professionnelle, son engagement et sa motivation. Finalement, la « pathologisation » du comportement du salarié exonère les entreprises de toute responsabilité dans le phénomène décrié et les conforte dans la prescription de toutes sortes de remèdes. Certes, ceux qu’on surnomme les responsables du bonheur en entreprise (chief happiness officers en anglais) encouragent la joie au travail à grand renfort d’événements fédérateurs et d'aménagements de confort – salles de sieste, tables de baby-foot, etc. –, mais cela ne semble pas réussir à inverser la tendance. À vrai dire, même les primes proposées aux travailleurs pour qu’ils prennent en charge des tâches supplémentaires ne suffisent plus.
Toutes ces mesures se révèlent donc inefficaces parce que ce qui se joue ici est bien plus profond qu’un mal-être professionnel ou qu’une quête de reconnaissance insatisfaite; on parle plutôt d’une mutation, d’un véritable repositionnement des valeurs au sein duquel le travail perd sa place dominante. Bref, il n’y a rien de symptomatique d’un quelconque dysfonctionnement. Dans un cadre de travail sain, les salariés qui ne font pas plus que les tâches leur incombant trouvent la plupart du temps du sens à leur travail et sont engagés dans leur entreprise. Cependant, l’arbitrage entre la vie professionnelle et la vie privée s’effectue différemment, probablement de plus en plus à l’avantage de cette dernière.
Des valeurs qui changent
Il est probable que ce changement de paradigme soit le résultat d’un double mouvement de valeurs. Le premier d’entre eux est le recul de la valeur travail. C’est un fait, celle-ci ne tient plus ses promesses, et le contrat tacite entre l’effort qu’on déploie au bureau et la récompense d’une retraite longue et heureuse est obsolète. Les jeunes salariés d’aujourd’hui devront travailler plus longtemps, avec un niveau de vie plus faible. Résultat : ils redoutent pour la plupart le départ à la retraite, qui, loin de représenter un eldorado oisif et élégant, est pour eux synonyme de précarité. C’est ainsi que le travail a perdu sa capacité à promouvoir la qualité de vie.
Dans le même temps, la société se transforme (la pandémie a certainement joué un rôle dans cette évolution), et les jeunes actifs accordent de plus en plus d’importance à leur vie personnelle. Ils veulent profiter de leurs enfants, leur couple, leurs amis et leur vie, conscients que, plus tard, il sera trop tard pour le faire. Le nombre croissant de pères qui quittent le bureau plus tôt pour aller chercher leurs enfants à l’école, chose rarissime il y a encore quelques années, témoigne notamment de cette mutation sociale. Ces deux mouvements contraires – une montée en puissance de l’importance de la vie personnelle et une perte de capacité du travail à promouvoir cette même vie – pourraient expliquer un tel changement de paradigme.
Doit-on pour autant en conclure que l’humanité s’est désengagée du travail ? Non ! C’est probablement le travail qui s’est désengagé de l’humanité, du moins dans les sociétés occidentales. Cette expression, « démission silencieuse » (ou quiet quitting), exprime une perte de contact entre le monde du travail et celui des travailleurs. Cela se traduit par des analyses parfois en décalage total avec la réalité. Ne lit-on pas parfois que « les salariés aiment la diversité », qu’ils ont «plusieurs employeurs»? Il faut nuancer leur réalité ainsi : le travail ne paye plus assez et ils doivent justement, bien souvent, multiplier les employeurs.
Dessine-moi un travail
Dès lors, on s’attend à ce que le mode de travail se réinvente. Il ne doit plus être que l’un des moyens de la performance économique, toujours légitime dans une économie concurrentielle, mais également un moyen d’épanouissement des individus. De ce fait, le travail au service de la qualité de vie devient un complément nécessaire à cette même qualité de vie au travail. Dit en d’autres termes, le travail n’est pas un ingrédient économique au même titre que le capital pour la performance globale, mais bien un objectif en soi de la valorisation de l’individu. Ce dernier ne doit plus être considéré comme un élément de la masse : sa singularité doit être mise au cœur de l’organisation.
Les entreprises sont donc tenues d’accepter, dans une bien plus large mesure, la flexibilité du travail, ce qui comprend les horaires de début et de fin de travail, le travail à distance, les dates de congé, etc. Elles doivent réduire la verticalité de la décision – certes décriée, mais toujours appliquée de manière massive chez nombre d’entre elles –, et cela en impliquant davantage les salariés. N’oublions pas en outre que les jeunes générations sont en quête de sens ; ainsi, l’augmentation du chiffre d'affaires ou des parts de marché ne peut suffire à les satisfaire. Dans ce cadre, il importe que l’entreprise démontre – non seulement auprès de sa clientèle, mais également auprès de sa main-d’œuvre – son utilité sociale de même que son bienfait sociétal.
Docteur en psychologie cognitive et enseignant-chercheur à l'ESDES, Lyon Business School.
Enseignant-chercheur et doctorant en sciences de gestion de l'Université de Bourgogne.