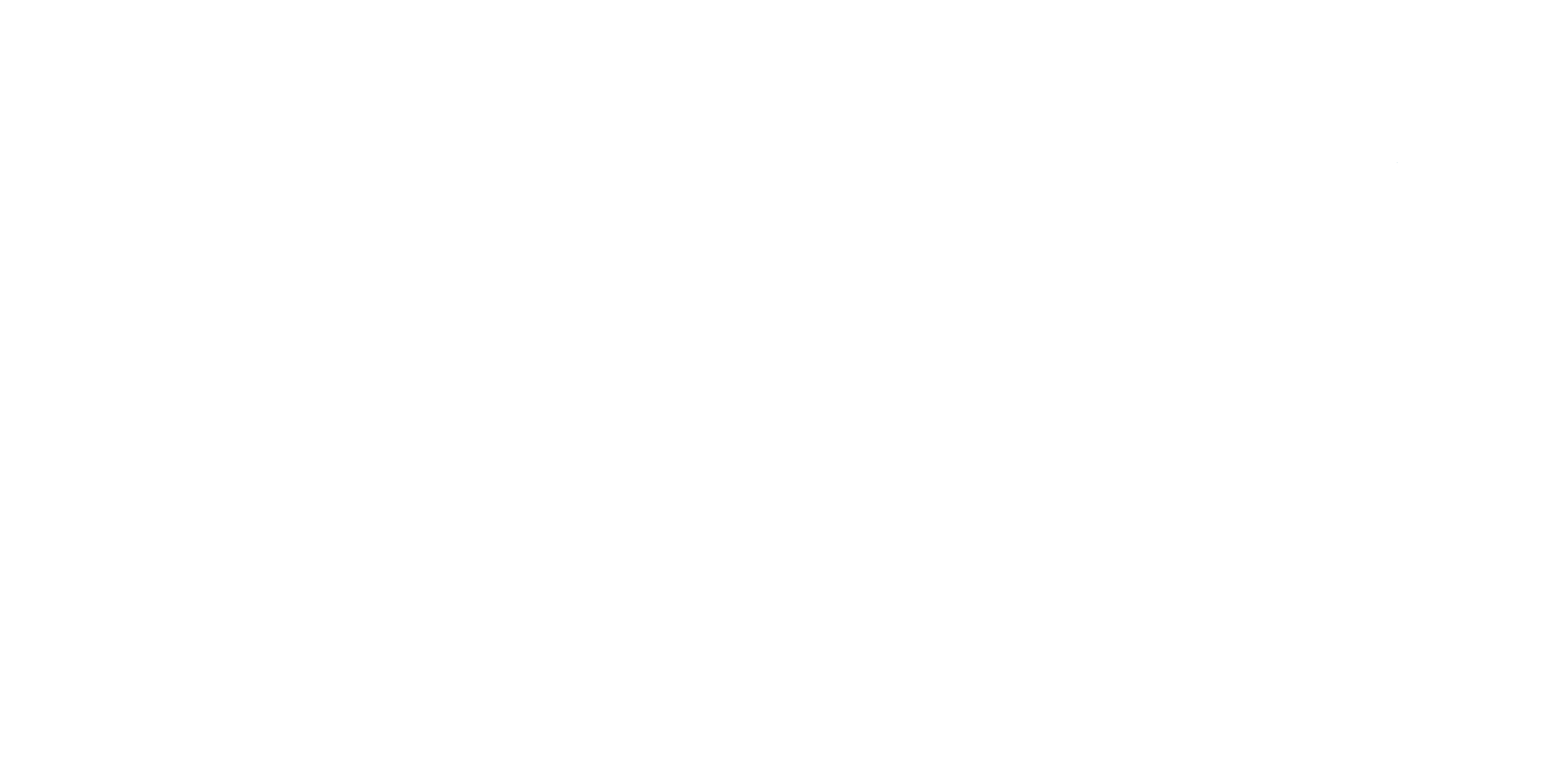- Accueil
- Le blog de l'ESDES
- Recherche
- Pour une stasiologie appliquée à l’entreprise
Benjamin Chapas
6 min.
8 février 2024
Pour une stasiologie appliquée à l’entreprise [1]
« Bienveillance », « humanisme », « altruisme », etc., les discours sur l’entreprise sont souvent teintés d’une rhétorique de la bonté qui appelle inévitablement le consensus. En effet, comment ne pas être d’accord avec l’argument autour duquel tous sont construits, selon lequel cette « institution cardinale du capitalisme » n’est en rien condamnée à être un lieu où ne pourrait s’exprimer que la violence et la domination et qu'elle peut, au contraire, accueillir et se nourrir des valeurs d’entraide, de solidarité ou encore de générosité ? Sauf à cultiver une position de pur cynisme, on ne voit pas ce qui interdirait de penser que l’entreprise puisse être ainsi le théâtre où l’on honore des exigences de communalisation, et c’est d’ailleurs un enjeu fondamental de la qualité de vie au travail et, pour les managers, une préoccupation quotidienne qui les oblige à remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier. Les exemples d’entreprises dans lesquelles il fait manifestement « bon travailler » sont d’ailleurs très nombreux, comme en témoignent les classements du type « Great place to work » qui recensent les meilleures entreprises en termes de pratiques managériales et RH, valorisant par là-même des modèles de développement économique de l’entreprise à la fois plus justes et plus humains.
Cette possibilité ne doit pas occulter le fait que l’entreprise n’en demeure pas moins un espace politique nourri par des formes diverses de contestation, d’interruption ou de dislocation à travers lesquelles s’affirment et émergent des subjectivités, et que le « bien » et les valeurs qu’on peut lui associer peuvent faire l’objet de profonds désaccords entre les parties prenantes de l’entreprise. L’entrée de l’entreprise en société a effectivement pour corollaire une exacerbation sans précédent des tensions polémogènes autour de sa « raison d’être » et des missions pouvant lui être confiées dans la perspective de sa responsabilisation sociétale et environnementale, et plus largement d’une « raisonnabilisation » du capitalisme. Aux conflictualités ordinaires du travail sur la nature du rapport salarial et l’évolution des conditions de l’emploi (révolution digitale et IA, ubérisation, etc.), se surajoutent notamment les nouvelles formes de conflictualité qui naissent à l’épreuve des mouvements sociaux écologistes ou de certaines obsessions identitaires contemporaines. Or, quand la lutte des classes fait ainsi place à celle des races, des genres et des identités, on comprend aisément que tout discours sur l’entreprise bienveillante et humaniste puisse sonner faux ou apparaître quelque peu naïf tant cette extension du domaine de lutte menace la « paix industrielle » et impacte les modalités de construction de la coopération en entreprise (voir notre prochain billet).
Une vision constructive du conflit
Entre la posture cynique qui empêche de penser que l’humanisation de l’entreprise et du management puisse être autre chose qu’une chimère et une vision par trop irénique de l’entreprise « bienveillante » ou « humaniste », un effort doit donc être fait pour réfléchir la dialectique qui unit les forces de conflit et celles de l’union, et qui donne au conflit sa dimension constructive. Le conflit, en effet, est un facteur d’équilibre social que rien ne condamne à l’improductivité de divisions sans fin et qui peut irriguer une conception plus riche et généreuse du commun quand les conceptions individuelles du « bien », si tant est qu’elles émergent, trouvent à s’affronter, s’affiner, se préciser, et in fine s’adapter au contact les unes des autres. Le conflit de ce point de vue n’est ni bon ni mauvais, mais la manifestation d’une différence, l’expression naturelle de la diversité indispensable à la vie qui s’avère d’autant plus bénéfique en entreprise qu’il y est rarement à somme nulle, tous les acteurs de l’entreprise ayant un intérêt personnel à travailler en commun. C’est ainsi que Mary Parker Follet (1924) parlait de la nature constructive du conflit, faisant l’éloge de la diversité des compétences, des parcours et des expériences individuelles qui permettent de faire progresser la société et la démocratie, ou plus modestement de faire fonctionner au mieux une organisation.
En sorte que ce n’est pas tant le consensus, ni même la recherche du consensus, que l’entreprise devrait rechercher dans cette perspective, mais le(s) conflit(s), ou plus exactement une manière de faire vivre le(s) conflits qui ne soit pas motif à son éclatement mais, au contraire, un moyen pour renforcer. Sauf à ce qu’ils soient de pure forme, l’existence de dispositifs participatifs est d’ailleurs elle-même conditionnée au fait qu’ils parviennent à susciter de la conflictualisation et des conflits, la logique du conflit dominant les conditions de la coopération en entreprise dans la mesure où c’est à partir de leur opposition et de leur confrontation que l’on peut établir entre ses différentes parties prenantes une zone de coopération mutuellement fructueuse. Mary Parker Follet, encore elle, estimait d’ailleurs que lorsque les gens disent vouloir en finir avec un conflit, c’est en réalité qu’ils veulent en finir avec la diversité, comme pour rappeler qu’un conflit n’est pas un problème à résoudre ou à éliminer nécessairement, mais bien davantage un mode de participation qui permet à chaque acteur de l’entreprise de prendre sa part dans la définition d’un commun ainsi repensé selon les critères de la justice démocratique (voir notre précédent billet).
Encourager une culture de la conflictualité
C’est pourquoi jeter les bases d’une « stasiologie [2]» appliquée au monde de l’entreprise nous semble opportun, cette discipline visant à mettre en lumière les conditions à remplir pour que des divisions existantes entre les groupes sociaux puissent naître une union sociale d’autant plus solide et durable que consciente de son ancrage polémogène. Ce qui ne signifie pas, pour autant, qu’il faille « tout conflictualiser » selon une stratégie qui entend cultiver les antagonismes politiques et se refuse à penser la relation dialectique entre le compromis – l’ordre – et le conflit – le désordre. Il s’agit plutôt de créer un climat social et une atmosphère organisationnelle qui encouragent l'autonomie et la responsabilité individuelle afin que chaque acteur de l’entreprise sente que sa contribution peut être importante et significative pour la cohésion de l’entreprise.
On ne peut en appeler à une culture de la conflictualité sans mettre ainsi l’accent sur les mœurs à l’appui desquels l’énergie conflictoïde produite en creux des rapports sociaux en entreprise peut se transmuer en un carburant pour plus de solidarité et de réciprocité. Dans cette visée, qui consiste à rappeler que si c’est toujours avec autrui qu’on est en relation conflictuelle, c’est toujours avec autrui que l’on est également dans un rapport de solidarité, de bienveillance et de sympathie, c’est pourquoi il est également important d’aplanir la hiérarchie et de réduire la bureaucratie, deux facteurs qui en général freinent l'enthousiasme des individus à participer et, par conséquent, empêchent l’expression et la résolution constructive des conflits. Et c’est aussi, in fine, ce qui invite à privilégier un management et des modes de gouvernance qui font la part belle aux compétences et aux capacités des acteurs de l’entreprise, et notamment celles qui permettent de travailler à une direction sociale de l’économie à la fois plus cohérente sur la création, mais aussi sur le partage de valeur.
Enseignant-chercheur & Responsable de la spécialisation Management, Sciences Humaines et Innovation de l'Esdes Business School
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Ce billet reprend des éléments développés dans notre article « La réhabilitation de la dimension constructive du conflit comme fondement d’un programme de recherche politique pour une gouvernance partagée de l’entreprise », à paraître dans la revue Finance, Contrôle, Stratégie.
[2] Par stasis, il faut entendre la dialectique de la guerre que les membres d’une même communauté – souvent d’une même famille – se livrent pour mieux se retrouver. Pour une introduction à ce concept, voir Agamben, G. (2015). La guerre civile. Pour une théorie politique de la Stasis. Points. Pour un développement plus dense consacré à son rôle dans la fondation de la cité athénienne, voir Loraux, N. (1997). La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes. Payot.